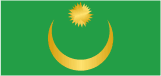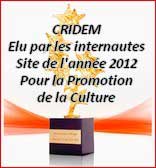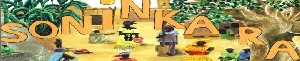10-09-2025 23:15 - Haratines : une identité ethnoculturelle irréductible face aux thèses assimilationnistes

L’identité haratine ne saurait être réduite à un simple débat terminologique ou à une fiction idéologique. Les thèses assimilationnistes qui s’efforcent de présenter les Haratines comme une « classe sociale » intégrée ou en transition, un appendice démographique des Arabo-Berbères, ou un sous-groupe sans substance autonome, reposent sur des postulats fragiles et non scientifiques .
L’anthropologie, l’ethnologie, l’histoire sociale et l’ethnolinguistique convergent pour démontrer le contraire : les Haratines forment une communauté distincte, façonnée par une mémoire collective, des pratiques culturelles spécifiques et une trajectoire historique singulière.
Descendants d’esclaves pour la grande majorité, ils portent encore aujourd’hui l’empreinte sociale de cette origine. Toutefois, leur identité ne se limite pas à cette assignation : elle est tangible, visible et profondément enracinée dans l’histoire longue des sociétés ouest-sahariennes.
Assimiler les Haratines aux Arabo-Berbères, en niant leurs différences, revient à ignorer les rapports sociaux asymétriques issus de l’esclavage et les hiérarchies symboliques qui perdurent au-delà des abolitions officielles (1981, 2007) et de la criminalisation par la loi n° 2015-031 (Journal Officiel de Mauritanie, 2015).
Comme l’a montré Claude Meillassoux (Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent, 1986), l’abolition supprime le statut juridique de l’esclave, mais non les rapports sociaux qui l’ont institué. Emmanuel Terray (Marxism and Slavery, 1980) rappelle de son côté que l’esclavage ne se réduit pas à un mode de production : il constitue une structure sociale durable qui façonne les positions hiérarchiques bien après sa disparition formelle.
L’ethnologie et l’ethnolinguistique confirment que le partage d’une langue ou de traits culturels n’efface pas les frontières identitaires. Fredrik Barth (Ethnic Groups and Boundaries, 1969) a démontré que l’ethnicité se définit par les frontières sociales et la reconnaissance mutuelle entre groupes.
Bruce S. Hall (A History of Race in Muslim West Africa, 1600–1960, 2011) ajoute que les catégories issues de l’esclavage, en Afrique de l’Ouest musulmane, se sont consolidées comme marqueurs sociaux et ethniques distincts.
Ainsi, l’identité haratine ne peut être confondue avec celle des Arabo-Berbères : elle constitue une réalité ethnoculturelle autonome, nourrie d’histoire, de mémoire, de pratiques culturelles et de rapports sociaux spécifiques. Reconnaître cette distinction, c’est non seulement répondre à une exigence académique, mais aussi déconstruire les lectures assimilationnistes et contribuer à une compréhension scientifique rigoureuse de la société mauritanienne.
1. L’héritage de l’esclavage comme matrice identitaire
Claude Meillassoux a montré que l’esclavage, même aboli, continue à produire des hiérarchies sociales durables : « l’abolition supprime le statut juridique de l’esclave, mais non les rapports sociaux et symboliques qui l’ont institué » [1].
Cette analyse éclaire la condition des Haratines : descendants d’esclaves, ils subissent encore aujourd’hui un stigmate social et économique, malgré les abolitions de l’esclavages successives de 1981, 2007 et sa criminalisation de 2015 par la loi 2015_031 qui corse les sanctions.
De son côté, Emmanuel Terray rappelait que l’esclavage n’est pas seulement un mode de production, mais aussi une structure qui ordonne durablement les relations sociales [2]. En Mauritanie, cette structure a façonné la place des Haratines dans la société, les assignant à une position subalterne transmise de génération en génération.
2. De la classe sociale au marqueur ethnique
Bruce Hall a démontré que, dans l’Afrique de l’Ouest musulmane, les catégories issues de l’esclavage ont progressivement pris la forme de marqueurs raciaux et ethniques [3]. Ce processus est pleinement observable en Mauritanie : les Haratines ne sont pas seulement identifiés par leur statut d’anciens esclaves, mais comme un groupe social et culturel distinct, porteur d’une mémoire spécifique.
L’anthropologue mauritanien Abdel Wedoud Ould Cheikh a lui aussi montré que les Haratines occupaient, dès la période précoloniale, des rôles économiques et militaires spécifiques qui ont contribué à leur cohésion sociale [4]. Cela confirme que leur identité dépasse la simple assignation sociale : elle s’inscrit dans l’histoire et la mémoire collective.
3. Identité ethnoculturelle et mémoire collective
L’identité haratine se nourrit de l’expérience historique de l’esclavage et des formes de mémoire collective qui en découlent. Bruce Hall (2011) souligne que les catégories serviles en Afrique de l’Ouest se sont transmises sur plusieurs siècles, transformant une condition imposée en identité sociale durable. Ce processus explique pourquoi les Haratines, bien qu’affranchis juridiquement, continuent d’être perçus et de se percevoir comme un groupe distinct.
En Mauritanie, cette mémoire se traduit par une conscience collective forgée dans l’exclusion et la marginalisation. Zekeria Ould Ahmed Salem (Prêcher dans le désert. Islam politique et changement social en Mauritanie, 2013, p. 141) montre que les mouvements sociaux haratines, tels que le groupe « El Hor » dans les années 1970, ont élaboré leur identité en articulant deux dimensions : la lutte contre l’héritage esclavagiste et la revendication d’une reconnaissance spécifique au sein de la nation.
Cette mémoire historique et politique témoigne d’une continuité : les Haratines ne peuvent être réduits à une composante assimilée des Arabo-Berbères. Ils constituent une communauté autonome, porteuse d’une histoire propre, d’un vécu collectif et d’une conscience identitaire affirmée. L’exemple du Rwanda, étudié par Jean-Pierre Chrétien (1995), illustre bien ce phénomène : Hutu et Tutsi partagent la même langue, mais leurs mémoires collectives et leurs hiérarchies sociales ont façonné des identités distinctes.
De la même manière, en Mauritanie, les Haratines partagent la langue hassaniya avec les Arabo-Berbères, mais leur condition sociale, leur mémoire de l’esclavage et leurs pratiques culturelles spécifiques les distinguent profondément.
Ainsi, l’identité haratine apparaît comme le produit de l’histoire et de la mémoire : elle se transmet à travers les générations, s’incarne dans des pratiques culturelles propres et se consolide par la reconnaissance mutuelle interne et externe. C’est cette mémoire collective, héritée, reconstruite et constamment réactualisée, qui confère aux Haratines leur irréductible singularité ethnoculturelle.
4. Mémoire collective et pratiques culturelles spécifiques
Jean et John Comaroff, analysant les sociétés coloniales d’Afrique australe, ont montré que les communautés dominées survivent en préservant des réseaux de mémoire et des pratiques culturelles endogènes [7]. Ce mécanisme se retrouve pleinement chez les Haratines.
Leur culture populaire s’est structurée autour de pratiques artistiques et sociales spécifiques, qui constituent autant de signes distinctifs de leur identité : la Neyfara ou flûte, le Leeub debouss ou danse du bâton à forte symbolique guerrière, le jeu du Zeg aari, le Leub chaate apparenté à la capoeira brésilienne, le Tay ouz vleumrah, le Leub el koura qui ressemble au hockey sur glace, ainsi que l’usage des percussions du Tbel, le grand tambour aux multiples fonctions.
Ces pratiques témoignent d’une mémoire collective nourrie de résistances, d’affirmation de soi et de transmission intergénérationnelle. Elles rappellent que, même en situation de marginalité, les Haratines ont su préserver des formes d’expression qui affirment leur dignité et leur cohésion. Mais c’est surtout à travers le medh, chants de louanges au Prophète Mohammed (PSL), que s’exprime la profondeur de cette identité.
Dans les adwabas, ghettos d’esclaves ou d’affranchis toujours situés en contrebas ou à l’écart du vrig, campements des maîtres, le medh constituait le seul espace où les anciens esclaves pouvaient retrouver une part d’humanité face aux humiliations, aux discriminations et aux souffrances du quotidien.
Ces chants collectifs, empreints de ferveur religieuse et de lyrisme spirituel, étaient à la fois un refuge, une source de consolation et un acte d’affirmation existentielle. À cet égard, le medh présente des résonances frappantes avec le gospel noir américain, né lui aussi dans le contexte d’une oppression systémique : les deux traditions transforment la douleur en un langage de foi et de résistance, en donnant à la communauté dominée un espace d’humanisation et de reconnaissance mutuelle.
Ainsi, loin d’être de simples pratiques folkloriques, la neyfara, le leeub debouss et surtout le medh constituent des vecteurs essentiels de la mémoire haratine, garants de la continuité d’une identité qui a survécu à l’esclavage et à l’exclusion sociale.
5. Diversité interne et cohésion identitaire
La diversité régionale ou sociale des Haratines n’invalide pas leur unité. Comme le rappelle Christian Bocquené dans son étude sur les Peuls du Cameroun, toute ethnie présente des variations internes, mais c’est la mémoire collective et la reconnaissance mutuelle qui fondent l’unité [8]. De la même manière, les Haratines peuvent être divers dans leurs expériences locales, mais ils se reconnaissent et sont reconnus comme un seul groupe, avec une trajectoire historique commune.
Conclusion
Les Haratines remplissent donc tous les critères qui définissent une communauté ethnoculturelle : mémoire historique, pratiques culturelles spécifiques, frontières sociales reconnues, auto-identification et reconnaissance externe.
Les adwabas, lieux de relégation hérités de l’esclavage mais aussi espaces de reconstruction et de mémoire, illustrent parfaitement cette trajectoire. Les réduire à une simple “catégorie sociale en transition” est un contresens scientifique. Reconnaître cette identité, c’est non seulement rendre justice à leur histoire, mais aussi poser les bases d’une Mauritanie véritablement inclusive et respectueuse de toutes ses composantes.
Bibliographie (tous les auteurs cités, liens cliquables)
[1] Claude Meillassoux, Anthropologie de l’esclavage : le ventre de fer et d’argent, Paris, PUF, 1986
[2] Emmanuel Terray, Marxism and Slavery, New York, Monthly Review Press, 1980
[3] Bruce S. Hall, A History of Race in Muslim West Africa, 1600–1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2011
[4] Abdel Wedoud Ould Cheikh, « Tribus, esclavage et pouvoir en Mauritanie », Cahiers d’études africaines, 2014
[5] Fredrik Barth, Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Boston, Little, Brown and Company, 1969
[6] Jean-Pierre Chrétien et al., Rwanda : les médias du génocide, Paris, Karthala, 1995 [7] Jean Comaroff et John L. Comaroff, Of Revelation and Revolution: Christianity, Colonialism, and Consciousness in South Africa, Chicago, University of Chicago Press, 1991
[8] Christian Bocquené, Les Peuls du Cameroun : étude ethnologique, Paris, Karthala, 1986
Par Cheikh Sidati Hamadi,
Expert senior en droits humains des Communautés Discriminées sur la base du Travail et de l’Ascendance,
Chercheur associé, Analyste, Essayiste.
Le 10 Sept 2025